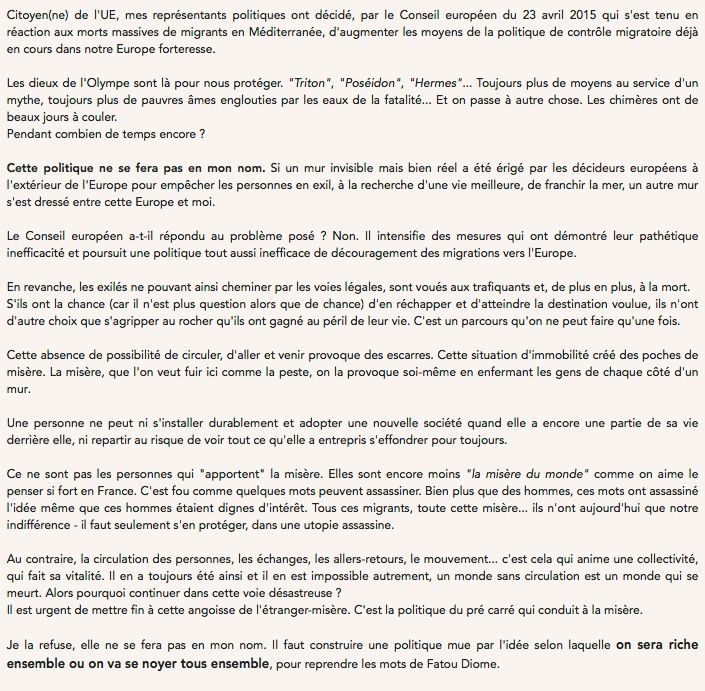"PROMENADE EN FORÊT
LA FORÊT PRIMAIRE DES TROPIQUES : SOUS BOIS ET CANOPEE
Comment est-elle, cette forêt ? Allons la visiter. Je propose une belle marche d’au moins trois jours avec le but précis d’aller à la rencontre du Radeau des cimes, ce qui nous donnera l’occasion de comparer le sous-bois et la canopée. Pour réussir cette « totale » en matière de forêt tropicale primaire, il nous faut un guide, des vivres, des machettes, du matériel pour grimper, des hamacs et des bâches pour abriter notre bivouac.
Notre guide se nomme-t-il Idriss, Thomas-Sankara ou Eusebio ? C’est égal, je connais les trois, on peut leur faire confiance. Sommes-nous à Bornéo, au Gabon, ou en Amazonie équatorienne ? Peu importe. Etonnant paradoxe, les hautes forêts équatoriales d’Amérique, d’Afrique, d’Asie et de Mélanésie sont identiques entre elles, même si la flore et la faune diffèrent totalement d’un continent à l’autre. Je parle ici de forêts « primaires », n’ayant pas été modifiées par les activités humaines, exploitation des bois, chasse ou orpaillage, agriculture ou prélèvements massifs de bois de feu ; si de telles modifications ont eu lieu, c’est à une époque suffisamment ancienne pour que le caractère primaire ait eu le temps de se reconstituer. Ce récit étant synthétique, on ne s’étonnera pas d’y trouver les faunes et les flores de nombreuses forêts tropicales. Commençons notre belle marche.
Le long de la route, une maison typique du tropique pauvre : murs de parpaings et toit de tôle ; un matelas sur une natte, un quinquet à pétrole, un tortillon contre les moustiques qui ajoute son parfum de fumée à l’odeur de terre battue et de feu dans l’âtre. Nous partons avant l’aube, pour profiter de la fraîcheur de la nuit. On entend les voisins tousser dans la maison d’à côté ; un enfant pleure dans la pièce voisine, éveillé par nos préparatifs. Le sentier traverse d’abord des jardins et des vergers, serpentant entre des rames d’ignames, des haies de gingembre et des groupes de grands bananiers que nous distinguons à la lueur des lampes frontales : la lumière fait taire les rainettes arboricoles. Les champs de maïs, de piment et de manioc se succèdent, séparés par des touffes de bambous, des troncs tombés, une végétation basse couverte de rosée, qui brille sous les lampes. Je marche sur des fruits trop mûrs qui répandent une odeur d’alcool. Premier ruisseau : nous avons les pieds mouillés avant même que l’aube ne pointe mais qu’importe, il fait tiède, le ciel est clair, la piste est bonne, notre guide chante, la journée s’annonce bien.
UNE HEURE DE GLOIRE
De façon assez soudaine, l’ambiance change : le bruit de nos pas devient plus sourd, comme si nous entrions sous un auvent, les feuilles sont moins chargées de rosée et la brume nous entoure ; des réseaux de racines forment une sorte de dallage sur le sentier, reliant les unes aux autres les bases des troncs couverts de mousse. Nous sommes dans le sous-bois ; dans l’air totalement immobile s’élèvent des odeurs d’humus, de bois pourri et de feuilles mortes ; l’ambiance, mélancolique et automnale, me fait chaque fois penser à la rentrée des classes. Quelques mots suffisent : nos voix n’ont plus le même timbre que dans une végétation ouverte. Le jour se lève, mais alors que le sommet des grands arbres accroche déjà le soleil, 50 mètres au-dessus de nos têtes, le sol est dans la nuit et nous hésitons encore à éteindre nos lampes. Le petit matin est brumeux, frais, incroyablement humide, d’un calme total et quelque peu solennel, troublé seulement par les impacts des gouttes d’eau tombant du sommet des arbres – la canopée – et percutant des écrans foliaires à des hauteurs variées. Le premier soleil traverse un air net, lavé, extraordinairement limpide au départ de la brume ; le petit matin est l’heure de gloire de la forêt, l’heure des lumières divines et du chant des oiseaux. Assis sur un tronc, nous attaquons une poignée d’arachides arrosée d’eau tiède, un petit-déjeuner dont le mérite tient surtout au décor qui nous entoure. Le sous-bois s’ouvre au désir de la découverte ; je remarque au sol nos premières plantes noires, nos premiers bégonias à feuilles bleues, nos premières baies rouges sur les tapis de géophiles et nos premières sangsues. La progression est facile. Il nous arrive, perdant le sentier, de nous retrouver dans un sous-bois intact, mais où la marche reste aisée : notre guide se contente de couper de temps à autre, d’un coup de lame sec et précis, une petite branche qui fait obstacle, une liane qui pourrait ralentir notre progression. Dommage que les fleurs soient si rares et les odeurs si mélancoliques… Le sous-bois a une double fonction de pourrissoir et de germoir, puisqu’il regroupe les plantes dont la vie est finie avec celles dont la vie commence ; des arbres tombés, des souches pourries investies par les racines des arbres alentour voisinent avec des tapis de graines ou de semis, de germinations ou de plantules.
Nous ne voyons aucun animal dangereux ; d’ailleurs les rares animaux que nous croisons – un varan, un rongeur, une timide couleuvre – sont craintifs et s’enfuient dans un bref crissement de feuilles mortes. Les seuls dangers sont de se perdre – mais cela ne nous arrivera pas, nous avons un guide – ou de se faire écraser par un arbre qui tombe ; un danger sérieux, d’autant qu’il est difficile à prévoir : un arbre peut s’effondrer en l’absence de vent, sous la charge croissante des lianes qu’il porte. Le danger, à vrai dire, peut venir de n’importe quel objet tombant de la canopée, une branche élaguée, un fruit dur comme du bois, ou même une touffe d’orchidées épiphytes. Au total, je voudrais faire partager cette conviction : une marche en forêt tropicale, c’est beaucoup moins dangereux pour la santé qu’un séjour à l’hôpital, un trajet en voiture sur une nationale ou une visite nocturne dans une banlieue morne où les barres des HLM le disputent en laideur aux parkings de supermarchés couverts de tags. Aucun vent : la fumée d’une cigarette reste verticale ; pourtant une foliole de palmier bat en cadence, mollement, dans un mouvement qui rappelle celui d’un aviron de godille derrière une chaloupe bretonne ; ou bien deux folioles voisines alternativement s’écartent et se rejoignent, comme deux mains qui applaudissent, tout ceci grâce à un courant d’air qui passe au-dessus de nos têtes et dont nous ne profitons pas. Dommage !
L’« impression de chaleur » que nous ressentons tous est en partie due à ce que, dans cet air très humide, notre transpiration ne s’évapore pas ; après une heure de marche on est trempé, même par temps sec. Pourtant, avec 25 ˚C, on ne peut pas dire que l’on souffre de la chaleur, étant à l’ombre des arbres, que la superposition des cimes rend particulièrement épaisse : en forêt primaire, la lumière au sol peut se réduire à 0,1% de la luminosité totale. Très haut au-dessus de nos têtes, la canopée, comme une immense verrière, laisse filtrer des lueurs vertes ; c’est là-haut, en pleine lumière, que se concentre la vie et que se trouve, à mon sens, le vrai visage de la forêt. L’alizé arrive, faisant alterner nuages et soleil avant d’instaurer, à la mi-journée, un grand ciel bleu où les rapaces planent en utilisant les « thermiques ». Nous avons atteint un secteur où la forêt primaire est particulièrement majestueuse : le sous-bois est très sombre et aucune plante n’y pousse. Sans fatigue ni sac à dos, on pourrait courir ou faire du VTT sur un tapis de feuilles mortes où les seuls obstacles seraient les bases d’énormes troncs, semblables aux piliers d’une cathédrale. Mais qui parle de courir ? La marche devient monotone et dans la lumière d’aquarium se succèdent les troncs moussus, les lianes, la boue, sans arrêt. Peut-être la faim commence-t-elle à se faire sentir, limitant nos capacités d’étonnement ?
La pause de midi ne me restera pas en mémoire comme un grand souvenir gastronomique, mais elle nous procure l’occasion d’écouter les voix étranges de la forêt : deux arbres qui gémissent lorsque l’alizé les fait grincer l’un contre l’autre, la rumeur des crapauds dans un lointain bas-fond marécageux, des fruits secs qui claquent, des cigales dans les hautes branches et leurs crissements d’arcs électriques.
Puis la marche reprend ; on monte, on descend, dans des odeurs de terreau et de champignons. De temps à autre nous traversons un incroyable parfum de fleur, mélange de glycine, d’olivier de Bohême et de rose de juin, qui descend de la canopée avec on ne sait quel djinn à l’envers et bouleverse les sens dans cette ambiance austère.
Même si on ne la voit guère, la faune a une part importante dans l’atmosphère quelque peu magique : passage vrombissant d’un colibri curieux venant voir qui nous sommes, rencontre avec un groupe de termitières à étages, chant sublime des gibbons – sans compter les sangsues, toujours affectueuses à notre égard, venant de très loin à notre rencontre et dont l’activité nous paraît digne d’une meilleure cause. Un Morpho passe, comme un éclair bleu métallique, et nous nous arrêtons, fascinés, jusqu’à ce que cet irréel ludion d’azur disparaisse en sautillant dans la pénombre : j’ai le sentiment d’avoir vu passer le plus beau papillon du monde.
LE GRAIN D’ORAGE
Le sous-bois ne se laisse plus parcourir aussi aisément : pour franchir les chablis – ces trous dans la forêt laissés par la chute des arbres –, notre guide doit ouvrir le passage à grands coups de machette : on se croirait dans un mauvais film. La chaleur est là ; la sécheresse de l’après-midi fait éclater les gousses au sommet des grandes Légumineuses et, au centre des chablis, on voit se flétrir les larges feuilles molles des arbres pionniers, Musanga, Cecropia, Neolamarckia ou Macaranga.
Vers le milieu de l’après-midi, les flèches de soleil au sol perdent de leur netteté ; le ciel devient blanc et le vent se lève ; des branches tombent des cimes balancées, avec des paquets d’orchidées, les graines volantes d’Alsomitra et les fruits ailés du keruing. Par prudence, pour ne pas risquer de recevoir une branche morte, nous faisons une halte sur un banc de sable de la rivière ; lorsque le mur de pluie arrive, notre guide, nullement importuné, en profite pour prendre une douche et laver son linge, mais moi qui ai amené d’Europe une vision nettement moins positive de la pluie, je ne peux que m’enrouler dans un imperméable et attendre : tout devient triste et aquatique pendant près d’une heure, avant que le grain d’orage ne s’éloigne et que le soleil revenu ne fasse luire les feuilles. Le torrent d’eau a rafraîchi l’atmosphère et c’est le moment de repartir ; sous les arbres, il pleut encore et, dans une délicieuse odeur de potager mouillé, le concert des batraciens devient assourdissant. Evitons d’écraser les escargots. Dans le sous-bois c’est déjà la pénombre, mais dans la canopée les hautes branches sont encore en plein soleil ; la marche devient dure et notre progression n’a plus le rythme de ce matin ; c’est long, c’est loin, le sac à dos est lourd et malcommode. Aux multiples spectacles que nous offre la forêt – de jolis fruits jaunes au sol, un couple d’oiseaux bleus, des lianes en rubans torsadés, une tortue occupée à manger des champignons, un tronc couvert de fleurs roses, une trace de pied d’éléphant pleine d’eau où nagent des têtards –, à toutes ces menues scènes de la vie forestière qui ce matin retenaient toute notre attention, la lassitude nous contraint de ne plus accorder qu’un rapide coup d’oeil. En continuant à marcher, nous courons le risque de traverser la forêt sans la voir : déjà elle nous échappe ; c’est le moment de bivouaquer.
Sur une berge en pente douce encore ensoleillée, notre guide dégage quelques mètres carrés, installe entre les troncs des cordes qui serviront à tendre les bâches pour protéger nos hamacs de la pluie. On fait sécher les vêtements sur les pierres du gué, on allume un feu, on chauffe de l’eau pour le thé : plaisante petite vie de village. La baignade donne à notre campement une ambiance de grandes vacances ; dans le soir qui descend, les éclats de rire résonnent en écho le long des rives. Les sangsues ont disparu. C’est l’heure admirable où, dans la forêt devenue délicieusement hospitalière, s’affirme le parfum des fleurs. La canopée s’est changée en un théâtre d’ombres sur fond rouge ; au-dessus de la rivière, je vois de grandes roussettes voler, toutes dans la même direction, à la recherche des fruits dont elles se nourrissent.
Un peu de musique – jazz ou grégorien, rock, opéra ou clavecin – et c’est un émerveillement complet. Je me suis souvent demandé pourquoi la musique prend, en forêt équatoriale, un relief aussi superbe. Une profonde adéquation unirait-elle ces deux extrêmes, le plus sauvage et le plus civilisé ? L’orage continue au loin, il fait frais, la nuit est tombée. Sous les bâches, c’est l’heure des braises et du punch au citron vert, dégusté pendant la cuisson du riz. Enigmatiques, les premières lucioles passent en clignotant ; la faune sonore s’éveille mais, dans le concert nocturne qui se met en place en haut des arbres, comment distinguer ce qui est grillon de ce qui est oiseau, singe ou rainette arboricole ?
La nuit est calme et fraîche, sonore, marquée de temps à autre par un orage lointain ou la plainte d’un rapace nocturne, comme un « solo » au-dessus du tendre concert des rainettes, par le plongeon d’une grosse bête inconnue ou la chute d’un arbre, très loin, de l’autre côté du fleuve. Dans le sous-bois, les phosphorescences mauves ou orangées des champignons du sol ou du bois pourri passent et pulsent. Entre les deux murailles noires de la forêt des berges, la Voie lactée se reflète sur l’eau sombre et la nuit tropicale s’écoule, tellement belle et tellement paisible… J’en suis sûr, les coupeurs de bois n’ont jamais ressenti une telle paix, n’ont jamais été sensibles à une telle beauté ; sinon, couverts de honte, ils changeraient de métier.
L’aube appartient aux oiseaux. Avant même que le ciel ne redevienne visible, nous percevons dans notre sommeil leur univers sonore en trois dimensions : appels en échos dans la canopée, dialogues de grands oiseaux de proie qui passent en troupe au-dessus de la rivière, douces notes plaintives répétées sans relâche ; un tout petit piaf survolté s’égosille juste au-dessus de nos hamacs : celui-là nous réveille.
De rapides ablutions, un bol de riz, un café. Le temps de rouler les hamacs dans les sacs à dos et la marche reprend au lever du soleil, en longeant la rivière. Le ronflement sourd d’une chute d’eau se fait entendre, de plus en plus fort à chaque méandre ; le soleil qui se reflète sur l’eau calme éclaire la forêt par-dessous de jolies lueurs mobiles. Un chant triste, d’un oiseau inconnu et lointain, emplit l’âme d’un déferlement poétique inattendu, aux dimensions océanes : toute la vie, toute la genèse de la vie et tout son drame dans ce chant-là, qui n’a que quelques notes. La forêt est belle, ce matin.
A partir de la chute d’eau, et à la boussole cette fois, nous replongeons dans la pénombre humide et fraîche du sous-bois ; deux bonnes heures sont nécessaires avant que notre guide ne parvienne à localiser cet objet improbable, une corde dont l’extrémité libre pend à 1 mètre au-dessus du sol, l’autre étant fixée dans la canopée. Le temps de s’équiper – harnais, baudrier, croll et jumars – et nous grimpons, l’un après l’autre. Faire l’ascension du sous-bois jusqu’à la canopée est une joyeuse expérience. Bien qu’il ne manque pas d’intérêt, j’en suis venu à considérer le sous-bois comme l’envers du décor. Dans un immeuble parisien, il équivaudrait aux locaux techniques du rez-de-chaussée : pénombre, air confiné, poubelles sous les vide ordures, gaines verticales pleines de câbles et de tuyaux. Cela n’a rien à voir avec les terrasses du huitième étage d’où l’on peut admirer l’île Saint-Louis et les tours de Notre-Dame.
L’ascension offre une belle vue de la structure verticale de la forêt. Depuis le sol, on ne voit que des strates de feuillage qui se superposent, et la canopée, la plus haute, n’est guère visible. Lors de la montée, chacune des quatre strates apparaît avec clarté. Combien de temps faut-il à un grimpeur pour atteindre le Radeau des cimes ? De dix à cinquante minutes selon sa condition physique ; mais c’est moins dur qu’on ne le craint, et tout le monde parvient à monter.
SUR LA CANOPÉE DE LA FORÊT PRIMAIRE
Un grand choc, climatique, esthétique, émotionnel, attend ce grimpeur qui, par une belle matinée ensoleillée, sort du trou d’homme, à 45 mètres de hauteur, encore étourdi par l’effort, réclame une gourde, se débarrasse de son baudrier, s’assoit sur une poutre pneumatique gonflée à bloc par la chaleur et entreprend d’observer ce qui l’entoure. Rien ici ne lui rappelle le sous-bois, dont l’austérité est vite oubliée ; la lumière est éblouissante, le Soleil au zénith et le thermomètre indique 39 ˚C à l’ombre. Quelle ombre ? La seule sur laquelle on puisse compter est celle des nuages de beau temps dont l’alizé pousse l’amical troupeau dans le ciel d’un bleu délicat. Au premier plan s’exprime l’exquise délicatesse de ce nouvel univers : au-dessus d’une cime, une liane gracile balance, au bout d’un long flagelle, des gousses roses d’une fragilité extrême et la lumière du matin s’attache à une minuscule toile d’araignée couverte de rosée. Le vrai visage de la forêt.
Stop ! Admirer la canopée impose de prendre en compte, d’abord, quelques aspects techniques qui ne sont plus ceux du sous-bois et il est urgent de nous équiper. Ici, les objets indispensables sont les lunettes noires, le chapeau à larges bords, la crème solaire, une gourde bien pleine et surtout un harnais de sécurité muni d’une longe permettant les déplacements, comme si nous étions sur le pont d’un voilier en haute mer. La visite peut commencer. L’air sec de midi donne une visibilité excellente : au-delà des arbres « émergents » dont les cimes formidables dominent la canopée de plus de 20 mètres, je distingue une large vallée bordée de collines au-dessus desquelles tournent des rapaces, et plus loin encore, à l’horizon, de très lointains reliefs tabulaires bleuis par la distance.
Autour de nous, le feuillage des arbres est d’une densité telle qu’il est impossible de voir le sol ; à peine devine-t-on, au travers du filet noir d’aramide, de grosses branches couvertes d’épiphytes, fougères et orchidées. Les feuilles des arbres, coriaces, brillantes, de dimensions plutôt modestes, contrastent avec celles des lianes, dont les palmes majestueuses des rotins ; on voit les vigoureuses étoiles des palmiers Euterpe dans une profonde grotte verticale où miroite une crique qui circule sous la forêt ; une puissante odeur d’humus monte jusqu’à nous.
A perte de vue, les bombements des cimes, comme de gros buissons denses, composent une canopée fermée sur laquelle circule l’ombre des nuages ; faute de voir les troncs, on oublie que des arbres nous portent : à ce titre, ils méritent notre reconnaissance.
Les arbres tropicaux ? La grande affaire de toute mon activité de botaniste. Grâce à Roelof Oldeman, à Barry P. Tomlinson et à d’autres passionnés d’arbres, nous avons pu analyser leur architecture, montrer leur nature coloniaire – comparable à celle d’un récif de corail –, comprendre le polymorphisme de leurs génomes, mesurer leur virtuosité biochimique et accéder à l’idée de leur immortalité potentielle. Dans le même temps, les paléoanthropologues Yves Coppens et Pascal Picq démontraient que le genre Homo était né dans le haut des arbres, sur une canopée équatoriale, il y a de cela plusieurs millions d’années. C’est pour nous une impression étrange d’être revenus là où sont apparus nos ancêtres ; mais l’être humain a beaucoup changé et nous avons le sentiment de ne plus être à notre place : la canopée n’est ni hostile ni accueillante, elle est indifférente à notre égard. Ce n’est pas pour nous qu’elle existe, elle joue un jeu dont les règles nous échappent, et, superbement, nous ignore. Le paysage n’en est pas moins beau.
Les fleurs, rares en sous-bois, ici sont chez elles et on en voit partout, dans des positions insolites, sous des formes et des couleurs inattendues : celles-ci, semblables à de petits ballons roses surmontés d’étoiles violettes, sont celles d’un Symphonia dont elles couvrent les branches horizontales ; celles-là, jaune d’or, toutes dressées dans le même sens avec leurs étendards et leurs éperons, sont si nombreuses qu’elles donnent à la cime du Vochysia l’allure d’une montagne de fleurs aux couleurs tellement vives qu’elle semble éclairée par l’intérieur, attirant un vol de colibris. Ici la cime vert sombre d’un Clusia, reconnaissable à ses larges fleurs plates, comme des soucoupes roses garnies en leur centre d’une cuillerée de miel. Sous nos pieds, visibles au travers du filet, les fleurs vertes d’une plante parasite parente du gui d’Europe surplombent les fruits vermillon d’un muscadier : arrivés à maturité, ils s’ouvrent sur une graine noire, brillante, partiellement recouverte d’un arille rouge dont les gibbons sont friands. Dès que le radeau aura quitté ce site, ces arilles vont être mangés et ces graines dispersées.
Dans l’après-midi, sous un ciel devenu argenté, la chaleur se fait lourde, la lumière forte et diffuse estompe les couleurs et il n’y a plus d’ombre nulle part : lorsque la provision d’eau commence à baisser, l’énorme chaleur donne une impression proche de la claustrophobie. Bien sûr, une solution simple et rapide consisterait à descendre pour retrouver la fraîcheur du sous-bois ; mais ce serait dommage car le spectacle s’accélère. Depuis la position élevée qui est la nôtre, on voit venir le changement de temps : une ligne de nuages en enclume se développe du côté du vent. Il reste quelques instants pour déployer la tente qui va nous servir de refuge : il convient d’y abriter rapidement tout ce qui craint la pluie car l’expression anglaise rainforest n’est pas seulement belle, elle est aussi parfaitement appropriée. Lorsque l’alizé forcissant nous apporte une bienfaisante fraîcheur, le « cunimbe » occupe déjà plus de la moitié du ciel et les reliefs tabulaires ont déjà disparu, avalés par la ligne de grains qui avance vers nous à vive allure ; nous entendons la pluie arriver, au bruit qu’elle fait en frappant la canopée, on dirait le puissant grondement d’une mer forte derrière les dunes.
Le coup de vent est brutal ; les cimes qui s’inclinent révèlent soudain leurs armatures internes. Les mots manquent pour décrire le parcours torturé d’énormes branches couvertes de jardins d’épiphytes, l’ascension verticale des troncs hors des ténèbres sous-jacentes, la danse échevelée des lianes. Sur la canopée parcourue par la houle, des vortex d’air ascensionnel entraînent, en guise d’écume, des vols de feuilles mortes, de graines ailées et de pétales fanés. Notre drôle de navire craque de partout, les amarres au vent peinent un peu, mais dans l’ensemble ça tient. On s’attendrait à voir des goélands mais ce sont de grands rapaces gris à queue fourchue qui planent face au vent.
L’arrivée de la pluie fait maintenant un bruit curieux, comme celui que feraient des pneus roulant sur le gravier d’une villa de luxe ; et le luxe, justement, ne nous fait pas défaut : sous la toile de tente battue par les rafales de pluie, bercés par le balancement de notre radeau, nous avons une bonne heure pour blaguer et boire du rhum en fumant des kreteks, dans une ambiance olfactive qui évoque à la fois le carré d’un cotre des Glénans et le marché de Surabaya. Cette énorme pluie est un événement quotidien, qui ne dure pas. Les nuages s’éloignent sous le vent et, dans l’alizé qui se calme, sous le grand ciel bleu qui sent la mer et le joli soleil revenu, la canopée se met à fumer et le paysage devient d’une indescriptible beauté.
Nous sommes soudain envahis par des vols de papillons et de libellules, et les insectes qui nous entourent ressemblent à des bijoux : un grand charançon bleu pétard, un longicorne qui essaie de se faire passer pour une guêpe, un bupreste vert métallique, une casside dorée marquée de deux larges taches noires. Avec le bon angle de vision, on peut s’abîmer dans la contemplation du jardin d’épiphytes couvrant l’énorme branche du grand Dipterocarpus sur lequel nous sommes posés : les grappes pourpres des orchidées jaillissent d’une moquette de délicates fougères reviviscentes, pour l’heure gorgées d’eau, qui servent de sol suspendu à de minuscules herbes aux fleurs délicates, bégonias, balsamines, gentianes saprophytes et même des utriculaires. Des utriculaires ! En Europe ce sont des plantes d’eau, ici elles vivent en haut des arbres : rainforest décidément n’est pas une expression usurpée ! Continuons d’explorer ce jardin d’épiphytes : sous les larges feuilles sombres d’un Philodendron, sous les inflorescences en gerbes de feu des Norantea, ces tiges grêles qui pendent, couvertes de baies de porcelaine mauve, sont celles d’une Ericaceae, proche de nos bruyères d’Europe. Aechmea, une Bromeliaceae parente de l’ananas, aux feuilles en gouttières, est pleine à ras bord, comme un pluviomètre ou un aquarium suspendu en plein soleil : dans ses 20 litres d’eau vivent des têtards et des crabes. Auprès de ces jardins suspendus, ceux de Babylone, l’une des Sept Merveilles du monde, devaient faire figure de modestes espaces verts de banlieue. Sait-on qui étaient les jardiniers de Babylone ? Ceux d’ici, en tout cas, on les connaît, ce sont des fourmis, transportant les graines des plantes qui leur sont utiles, dont elles composent les « jardins de fourmis » dominant leurs fourmilières ; il est vraisemblable qu’elles ont « cultivé » elles-mêmes le Philodendron, les Aechmea et beaucoup d’autres. Quant aux plantes qui ne sont pas utiles aux fourmis, les oiseaux en ont apporté les graines dans leurs fientes ; pour les orchidées, les bégonias ou les fougères, les graines ou les spores, fines comme de la poussière, arrivent avec le vent. C’est clair, nous sommes dans le paradis des naturalistes.
Le temps passe vite, à observer les êtres vivants qui nous entourent ; il fait tiède maintenant et la lumière s’est adoucie ; les cimes des arbres émergents sont encore dans le soleil mais, dans le sous-bois, c’est déjà la nuit. L’heure est venue de régler de menus problèmes techniques, faire le punch, réchauffer le dîner, préparer les lampes, les duvets et les moustiquaires, sans oublier d’admirer le joli coucher de soleil. Le bien-être s’installe, fait de confort, d’excitation devant la beauté du spectacle et d’une impression de totale sécurité. Nous avons renoué avec le sentiment qui devait être celui de nos ancêtres arboricoles lorsque, après une journée de chasse au sol, ils regagnaient leur refuge canopéen : le sentiment d’être inexpugnables. Les premières chauves-souris tournent et au crépuscule les parfums des fleurs s’exacerbent.
« LA SPLENDEUR SANS LIMITES DE LA NUIT TROPICALE »
La nuit tombe vite à cette latitude mais, bien avant qu’il ne fasse noir, le concert de la faune s’installe, spécialement puissant ce soir, puisqu’il n’y a pas de lune. Le concert nocturne de la canopée tropicale défie toute description ; les notes aquatiques et flûtées des innombrables rainettes arboricoles en constituent l’essentiel, surmontant un vaste bruit de fond dont les auteurs ne se laissent pas identifier et où les ultrasons des chauves-souris ont peut-être leur part. De temps à autre on distingue le chant des grillons, le cri des oiseaux de nuit, les appels des mammifères arboricoles, lémurs ou écureuils volants, au milieu d’autres cris animaux aux sons et aux timbres divers. Parfois, tout proche, un ahua fait entendre son chant rythmé, terrifiant et pathétique. Cette symphonie s’anime de pulsations comme si une autre houle, sonore celle-là, traversait le paysage : pianissimo dans la vallée, allegro vivace sur les sommets, puis, quelques minutes plus tard, les collines adoptent la pédale douce tandis que le bas-fond se déchaîne, fortissimo. Fascinés par cet assourdissant ressac, témoignage sonore de la diversité de la vie forestière, nous restons longtemps assis sur les poutres pneumatiques, sans parler, sans bouger. Au-dessus de nous, dans « la splendeur sans limites de la nuit tropicale », la Voie lactée est d’une impressionnante netteté et seul Joseph Conrad peut dire combien c’est beau ; au-dessous, à travers le filet, on voit clignoter les lucioles volant dans le sous-bois.
Il est difficile de dormir d’un trait jusqu’à l’aube parce que l’air est devenu humide, la température tombe à 19 ˚C, et l’impression de froid est réelle. Vers 3 heures du matin, la brume qui envahit chaque nuit le sous-bois forestier commence à surgir par les fissures de la canopée.
Très loin du côté du vent, plus loin encore que les reliefs tabulaires, on voit encore quantité d’éclairs, mais si lointains que l’on n’entend plus rien. Le concert de la faune est toujours aussi puissant mais avec un tempo plus calme, peut-être à cause de la baisse de température ; peu avant l’aube, tandis que les insectes font silence, avec les batraciens et les mammifères, l’orchestre canopéen devient l’affaire exclusive des oiseaux ; c’est le dawn chorus des Anglais, ornithologues passionnés. Il atténue un peu l’ambiance morose de l’aube qui s’approche.
Autant l’admettre : au réveil, nous ne sommes pas au mieux de notre forme ; assis sur des poutres pneumatiques avachies, dégonflées par le froid du matin et ruisselantes de rosée, nous contemplons nos duvets humides, nos tasses de thé froid et nos biscuits mous ; l’aube sur un voilier en haute mer est aussi faite de lassitude, d’humidité et d’un zeste d’écoeurement. Ici s’ajoute l’odeur fatiguée du sous-bois, montée jusqu’à nous avec la lumière grise de la brume. Mais patience : le soleil monte vite, la brume s’effiloche et l’alizé va nous remettre les idées en place. Alors, face à une canopée plus belle que jamais, il nous restera à affronter les véritables difficultés inhérentes à cet écosystème vierge : sans repères connus, l’être humain n’est plus chez lui et il souffre d’un flagrant défaut d’adaptation. Sa banque de données cérébrales submergée par d’incessantes nouveautés, il ressent alors la pénurie de catégories mentales adéquates, la faiblesse de ses aptitudes physiques, la pauvreté de son langage et l’insuffisance de ses mécanismes intellectuels, face à un milieu d’une complexité inégalée.
Pourquoi une telle complexité ? C’est que la canopée de la forêt tropicale présente la caractéristique étonnante d’être le milieu où vivent le plus grand nombre d’espèces animales et végétales, le milieu le plus vivant du monde."
In La Condition tropicale, Francis Hallé, Actes Sud, 2010
Texte copié ici
*
Un aperçu visuel avec le projet de film C'était la forêt des pluies, finalement sorti en novembre 2013 sous le titre Il était une forêt.